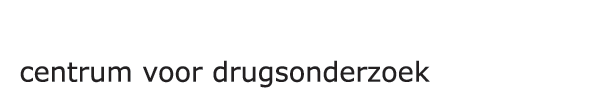Boekhout van Solinge,
Tim (1996), Le cannabis en France. In: Peter Cohen & Arjan Sas (Eds.)
(1996), Cannabisbeleid in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Amsterdam: Centrum voor Drugsonderzoek, Universiteit van Amsterdam. pp.
145-150.
© Copyright 1995 Tim Boekhout
van Solinge. All rights reserved.
3. La politique officielle en matière d'usage de cannabis
Tim Boekhout van Solinge
- La loi en matière d'usage de cannabis
- Les circulaires du Ministère de la Justice
- Le Nouveau Code Pénal
Jusqu'au ler mars 1994, toutes les dispositions concernant
les drogues figuraient dans le Code de la Santé Publique. Ces dispositions
étaient fondées sur la loi no. 70-1320 du 31 décembre
1970.
Avec l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal, le ler Mars
1994, toutes les dispositions, à l'exception de celles ayant trait
à l'usage de drogue, sont transférées dans ce dernier.
L'usage de drogue, parmi lesquels le cannabis, relève donc encore
aujourd'hui du Code de la Santé Publique.
Après la loi du 31 décembre 1970, le Ministère de
la Justice a publié différentes circulaires, adressées
aux procureurs généraux et procureurs, avec des directives
plus précises sur les procédures (juridiques) à suivre.
Contrairement à la situation aux Pays-Bas, ces directives ne sont
pas publiées par les procureurs généraux, mais par
le Ministère de la Justice. Il est également important de
savoir que les circulaires en France n'ont pas de statut impératif
ou force de loi; elles ont surtout une fonction indicative. Seule la loi
a un statut impératif. Un procureur ou un juge est donc libre de
déroger aux directives d'une circulaire, s'il estime que ces directives
ne sont pas bien adaptées aux "circonstances locales"de
sa circonscription, même si cela peut avoir pour conséquence
que la politique appliquée soit en contradiction avec les directives
de la circulaire.
La législation en matière de drogue est exceptionnellement sévère, non seulement en comparaison avec les critères européens, mais aussi avec celle des peines en vigueur pour les autres délits. La sévérité de cette législation apparaît également dans la réglementation de la garde à vue, qui ne doit pas normalement dépasser 24 heures. La garde à vue peut être prolongée de 48 heures jusqu'à 96 heures, exclusivement lorsqu'il s'agit d'une infraction à la législation sur les stupéfiants.
La loi en matière d'usage de cannabis
Comme on l'a vu précédemment, la loi du 31 décembre
1970 s'applique à l'usage de drogue, parmi lesquels le cannabis.
En vertu de l'article L-628 du Code de la Santé Publique, tout
usage de drogue est interdit, et par conséquent répréhensible.
Par ailleurs, il n'est pas question de toxicomanie dans la loi, mais seulement
d'usage simple de substances classées comme stupéfiants,
sans distinction entre les drogues douces et dures, ni même entre
l'usage en privé et en public, ou encore entre l'usage régulier
et occasionnel. Toute personne qui enfreint la loi, commet un délit
et est donc un délinquant selon la loi. Il s'expose à des
sanctions allant jusqu'à un an de prison et/ou une amende de 500
à 25.000 Francs.
L'infraction à la loi n'entraîne cependant pas par définition
de poursuites judiciaires; la loi du 31 décembre 1970 offre en
effet la possibilité de les prévenir grâce à
l'injonction thérapeutique. Cela implique le choix pour le procureur
de proposer à l'usager de drogue, à titre d'alternative
aux poursuites judiciaires, la suivie d'un traitement médical,
tel qu'une cure de désintoxication. Si l'usager peut présenter
un certificat médical, dans lequel il apparaît qu'il s'est
soumis à un traitement médical de ce genre depuis l'infraction,
le procureur ne peut pas procéder aux poursuites judiciaires. En
cas de récidive, le procureur examine s'il faut ou non passer aux
poursuites judiciaires.
Enfin, il existe encore la possibilité pour le procureur de classer
l'affaire, sur la base du principe d'opportunité des poursuites.
Les circulaires du Ministère de la Justice
Le législateur a pris conscience que la loi ne cadrait pas dans
tous les cas avec la réalité. Le but de suivre une cure
est en effet d'aider quelqu'un à se désintoxiquer, alors
qu'il n'en était pas question dans le cas d'usage de cannabis.
Le Ministère de la Justice a voulu remédier à cette
lacune de la loi au moyen de la circulaire du 17 mai 1978[21]
qui prescrivait qu'il fallait distinguer les produits du cannabis (à
l'exception de l'huile de haschich) des autres drogues en ce qui concerne
les effets sur l'organisme. Etant donné qu'il n'est pas question
de dépendance physique en cas de consommation de cannabis, on ne
peut considérer les consommateurs comme de vrais toxicomanes. L'alternative
à la poursuite judiciaire proposée par le législateur
grâce à l'injonction thérapeutique s'avérait
donc ne pas s'appliquer à ce groupe.
Il a donc été conseillé au parquet, en cas de l'usage
de cannabis, de ne procéder à des poursuites judiciaires
que si cela se présente comme indispensable et de se contenter
d'une mise en garde. Cela implique que l'usager est prié de s'adresser
à une personne qualifiée (par exemple le médecin
de famille) ou une association spécialisée pouvant lui apporter
une aide psychologique ou éducative. Etant donné que cette
mise en garde n'implique pas d'engagement pour le consommateur, et qu'il
n'existe d'ailleurs pas de contrôle ultérieur pour savoir
si le consommateur de cannabis a effectivement cherché une assistance
ou une information, cette mise en garde ne l'engage en fait à rien.
Une personne peut en principe recevoir plusieurs mises en garde. S'il
y en a vraiment beaucoup, des mesures structurelles peuvent être
prises, telles que l'injonction thérapeutique, avec alors un contrôle
pour savoir si la personne l'a suivie.
En 1984 est parue une nouvelle circulaire du Ministère de la Justice
: la circulaire du 17 septembre 1984[22],
qui donne des directives plus précises sur les étapes (juridiques)
à respecter en matière d'infraction à la législation
sur les stupéfiants. Bien que cette circulaire s'applique plus
au trafic de drogue qu'à son usage, elle donne également
quelques directives concernant l'usage de drogue. La circulaire indique
tout d'abord que des peines de prison sans sursis sont toujours prononcées -
bien que rarement - pour un simple usage de drogue. La circulaire poursuit
que la loi offre sans doute des possibilités de sanction, mais
qu'il ne faut pas oublier que ce recours a, dans ce cas, un caractère
exceptionnel. Dans le cas de consommation de drogue, sauf dans les cas
où les poursuites sont inévitables, le choix du Ministère
public doit s'exercer en faveur d'une intervention médico-sociale,
telles que l'injonction thérapeutique ou une prise en charge de
type socio-éducatif. En plus de ces deux mesures, indique ensuite
la circulaire, il existe encore la possibilité de faire une mise
en garde, comme cela a déjà été recommandé
en 1978, et surtout le signalement aux autorités chargées
de la santé publique.
Bien que la circulaire ne fasse pas explicitement la distinction entre
le cannabis et les autres drogues (contrairement à celle de 1978),
on peut en déduire une distinction implicite. En ce qui concerne
l'usage de drogue, cette circulaire maintient donc les directives de la
circulaire de 1978. Aussi le rapport de la Commission Henrion mentionne-t-il
que "le cannabis est actuellement consommé plus ou moins librement,
et pour tout dire presque banalisé et dépénalisé
de fait depuis la circulaire Peyrefitte de 1978, complétée
par une circulaire Badinter de septembre 1984".[23]
En 1987, le Ministère de la Justice a distribué une troisième
circulaire qui avait trait à l'application de la loi sur les stupéfiants
: la circulaire du 12 mai 1987.[24]
Cette circulaire, comme le dit la première page, précise
qu'elle annule les précédentes, pour des raisons de clarté
et parce que les parquets n'appliquent pas dans la pratique une politique
uniforme. Ceci est souvent oublié, comme par exemple dans le rapport
Henrion, qui ne fait absolument pas mention de cette circulaire. On pense
bien des fois que les circulaires de 1978 et 1984 (qui faisaient une distinction
entre le cannabis et les autres drogues) sont encore en vigueur, alors
qu'elles ont pris fin en 1987.
Cependant, la circulaire du 12 mai 1987 introduit un nouveau critère;
il n'est plus fait de distinction entre les sortes de drogues, mais entre
les usagers. La circulaire parle à ce sujet de "l'usager occasionnel"
et de "l'usager d'habitude".
Lorsqu'il est constaté que "l'usager occasionnel" est
bien intégré socialement (logement, travail, famille, etc.),
il est alors recommandé au parquet de se contenter d'un avertissement.[25]
La situation est différente lorsqu'il s'agit d'un "usager
d'habitude"; on entend ici par "usager d'habitude": quelqu'un
qui présente des signes d'intoxication, reconnaît se livrer
régulièrement à l'usage de drogue, ou quelqu'un qui
a déjà été arrêté pour des faits
analogues. La circulaire recommande au procureur de préférer
l'injonction thérapeutique, sauf dans les cas qu'il juge inévitables.
Si l'usager ne donne pas son accord à l'injonction thérapeutique,
il y a alors lieu d'envisager des poursuites pénales.
Etant donné que la dernière circulaire se base sur un autre
critère que les deux précédentes, il est difficile
de dire au premier abord s'il s'agit ici d'un assouplissement ou d'un
durcissement de la politique en matière de consommation de cannabis.
Si l'on considère toutefois que la circulaire du 12 mai 1987 a
été publiée sous le gouvernement Chirac (1986-1988),
on peut s'attendre à ce qu'il ne soit en aucun cas question, dans
la pratique, d'un assouplissement de la politique en matière de
drogue. Le gouvernement Chirac a en effet mené une politique plus
stricte en la matière (entre autres sous l'influence de Charles
Pasqua, Ministre de l'Intérieur) que les gouvernements socialistes
qui l'ont précédé. Albin Chalandon, à l'époque
Garde des Sceaux, aurait lui-même annoncé une croisade contre
la drogue, qui visait surtout l'usager de drogue.[26]
Le juriste Francis Caballero a d'ailleurs écrit, à propos
de la circulaire de 1987, que la dépénalisation précédente
de consommation de cannabis de facto a été retirée
implicitement avec cette circulaire.[27]
La politique plus sévère en matière de drogue du
gouvernement Chirac s'explique également par le fait qu'au cours
de son mandat ministériel, Gabriel Nahas était le conseiller
(officieux) de Chirac en ce qui concerne la politique en matière
de drogue. Or le médecin Gabriel Nahas professe en France des points
de vue (minoritaires) très controversés, au sujet du cannabis
notamment, et est considéré comme l'un des principaux opposants
à un assouplissement de la politique en matière de drogue.
Peu avant la fin du gouvernement Balladur, le Ministère de la
Justice a distribué conjointement avec le Ministère des
Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, la circulaire du
28 avril 1995, relative à l'harmonisation des applications de l'injonction
thérapeutique.
Tout d'abord la circulaire précise que la police et la gendarmerie
doivent constater par procès-verbal tout fait d'usage de drogue
et en aviser sans délai l'autorité judiciaire. Un procès-verbal
simplifié est disponible à cette fin. La circulaire indique
d'autre part que dès que l'usage de drogue a été
constaté, différentes possibilités sont à
envisager comme alternative avant d'engager la poursuite : l'injonction
thérapeutique ou le classement de l'affaire. Dans le dernier cas,
il existe deux variantes : ou l'usager s'en sort avec un avertissement,
ou il est signalé à la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), service chargé de l'exécution
de l'injonction thérapeutique.[28]
La circulaire donne des directives assez claires au sujet des cas dans
lesquels l'injonction thérapeutique peut être appliquée
:"les usagers de stupéfiants tels que l'héroïne
et la cocaïne, ou ceux qui s'adonnant au cannabis, en font une consommation
massive, répétée ou associée à d'autres
produits (médicaments, alcool, ...)".
La circulaire indique également que le classement sans suite est
une possibilité s'il s'agit d'une première consommation
de drogue ou d'un usage occasionnel, avec les deux variantes susmentionnées
(avertissement et nom transmis à la DDASS). Un avertissement signifie
dans ce cas que la personne reçoit un document dans lequel on lui
rappelle qu'elle a enfreint la loi et qu'elle est invitée à
prendre contact avec une instance spécialisée.
Etant donné que la circulaire parle constamment d'alternatives
(éventuelles) aux poursuites, il est clair qu'elle laisse une marge
au procureur pour juger s'il passe ou non aux poursuites. C'est pourquoi
il est encore trop tôt pour juger de l'application de cette circulaire
dans le futur.
Le Nouveau Code Pénal
Comme on l'a déjà noté, avec l'arrivée du Nouveau Code Pénal, le 1 mars 1994, toutes les dispositions relatives aux drogues, à l'exception de leur usage, y ont été transférées. Par la même occasion, cela a permis d'alourdir de façon considérable les peines. Il est maintenant possible par exemple de prononcer des réclusions criminelles de vingt, trente ans ou même à perpétuité pour pratiques mafieuses en matière de drogue. Le Nouveau Code Pénal, entré en vigueur le 1 mars 1994, comprend les dispositions suivantes :
- Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants est passible de la réclusion criminelle à perpétuité et/ou de 50.000.000 Francs d'amende (art. 222-34).
- La production ou la fabrication illicite de stupéfiants est passible de vingt ans de réclusion criminelle et/ou de 50.000.000 Francs d'amende (222-35, premier alinéa). Ces faits sont passibles de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée (art. 222.35, deuxième alinéa).
- L'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants est passible de dix ans d `emprisonnement et/ou de 50.000.000 Francs d'amende (art. 22-36, premier alinéa). Ces faits sont passibles de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée (art. 222-36, deuxième alinéa).
- Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition, l'incitation à l'usage de stupéfiants, par tout moyen, est passible de dix ans d'emprisonnement et/ou de 50.000.000 Francs d'amende (NCP, art. 222-37).
- Le blanchiment de l'argent de la drogue est passible de dix ans d'emprisonnement et/ou 1.000.000 Francs d'amende (art 222-38).
- L'offre ou la cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est passible de cinq ans d'emprisonnement et/ou de 500.000 francs d'amende (art. 222- 39, premier alinéa). La peine d'emprisonnement est aggravée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation, ou dans des locaux de l'administration (art. 222-39, deuxième alinéa).
Ce dernier article (222-39) figurait déjà dans le Code de la Santé Publique, avec les lois du 17 janvier 1986 (premier alinéa) et du 31 décembre 1987 (deuxième alinéa). Cet article (auparavant loi) permet d'attraper les petits dealers. La peine relativement faible est introduite pour permettre une procédure d'urgence. En effet celle-ci n'est pas possible en cas de délits passibles d'un emprisonnement de plus de 5 ans.