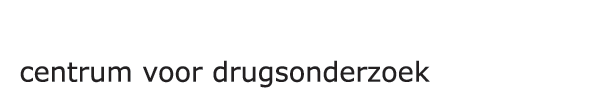Boekhout van Solinge,
Tim (1996), Le cannabis en France. In: Peter Cohen & Arjan Sas (Eds.)
(1996), Cannabisbeleid in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Amsterdam: Centrum voor Drugsonderzoek, Universiteit van Amsterdam. pp.
151-161.
© Copyright 1995 Tim Boekhout
van Solinge. All rights reserved.
4. La mise en oeuvre de la politique
Tim Boekhout van Solinge
La première observation qu'il faut faire au sujet
de la mise en oeuvre pratique de la politique en matière de drogue
est qu'il n'existe pas de politique uniforme en France. C'est pourquoi
il est plus exact de parler de différentes politiques en matière
de drogue. La politique, telle qu'elle prend forme dans la pratique, est
fortement déterminée par sa localisation régionale.
Même si la France est fortement centralisée dans bien des
domaines ou apparaît comme telle à l'étranger, il
n'en est pas de même dans le domaine de la politique (effective)
en matière de drogue. (Cela peut valoir pour d'autres domaines
aussi.)
En premier lieu, cela est dû à la politique suivie par les
différents parquets. Ils sont relativement autonomes dans la pratique
et ne suivent pas toujours les directives d'une circulaire. Il a déjà
été signalé précédemment que les circulaires
ont surtout une valeur indicative et n'ont pas de statut impératif
ou force de loi. Un procureur peut choisir de déroger aux directives
de la circulaire et donner plus de poids aux circonstances locales.
Il est parfois affirmé en France que l'usage de cannabis n'est
plus sanctionné dans la pratique. C'est en effet le cas dans certaines
circonscriptions, du moins lorsque l'usage est constaté pour la
première ou peut-être la deuxième fois. Dans d'autres
circonscriptions, notamment à la campagne, l'usage de drogue est
bien sanctionné et poursuivi.
Le fait que la distinction entre usage simple et détention soit
peu claire peut créer des complications. Ce premier relève
du Code de la Santé Publique; la seconde (et l'on peut être
considéré alors comme trafiquant) relève du Nouveau
Code Pénal (art. L 222-37) et est sanctionné beaucoup plus
lourdement, notamment jusqu'à dix ans de prison et/ou une amende
de 50 millions de Francs. Si l'on peut dire dans certains cas que l'usage
n'est plus sanctionné, la détention le reste.
La pratique judiciaire
Comparé aux Pays-Bas, il y a moins d'unité sur la politique
judiciaire en France, parce qu'il y a moins de contrôle du Ministère
public. Cela s'explique en partie par le fait qu'il est beaucoup plus
difficile de parvenir à une politique uniforme dans un grand pays
comme la France qu'aux Pays-Bas. Il y a par exemple en France 180 Tribunaux
de grande instance et procureurs, alors qu'aux Pays-Bas il y en a 30.
Dans la pratique il y a donc moins d'unité judiciaire en France
et la magistrature dispose de plus de pouvoir discrétionnaire qu'aux
Pays-Bas.
La différence de politique est également due au système
archaïque de répartition des Tribunaux de grande instance,
qui fait que l'on trouve ceux-ci dans des petites villes de province de
10.000 habitants. Non seulement il peut se produire de ce fait que les
procureurs de ces petites villes ne soient pas bien informés en
matière de (différence entre les) drogues, mais ils tiennent
aussi parfois compte de "circonstances locales" pour décider
de la conduite à tenir. Cela signifie dans la pratique que l'usage
de la drogue n'est pas accepté socialement et culturellement dans
les régions rurales, ce qui entraîne une application plus
stricte, ou plus à la lettre, de la loi que dans les grandes villes.
Cette constatation vaut pour les procureurs, mais également pour
les juges.
Il a déjà été indiqué au chapitre précédent
que les circulaires ont plutôt valeur de recommandations. Il est
important de s'arrêter encore sur ce point. D'après Catherine
Vannier du Syndicat de la Magistrature, qui est aussi substitut à
Laon (département de l'Aisne), "une circulaire n'a pas de
force juridique, c'est une valeur indicative. Il y a beaucoup de magistrats
qui vont appliquer la circulaire, mais ce n'est pas une norme qui s'impose.
Une circulaire n'a pas le même poids qu'une loi; c'est la loi qui
prime. (...) Le procureur va peut-être estimer que cette circulaire,
cette politique pénale, n'est pas franchement adaptée à
la situation dans sa circonscription. Il va pouvoir plus ou moins aménager
les directives générales du Garde des Sceaux par rapport
à la spécificité locale".[29]
Etant donné que la circulaire n'a pas force de loi, il n'existe
rien sur le plan formel qui retienne le parquet d'exiger des peines de
prison pour l'usage de cannabis, et par conséquent il n'y a rien
qui puisse retenir les juges de prononcer une telle peine. Suite à
la circulaire du 17 mai 1978, Emmanuel Filippis a écrit en 1984
que certains procureurs de province, et parfois également de banlieue,
n'hésitent pas à appliquer la loi avec sévérité.
Dans l'article, le Garde des Sceaux justifie cette application stricte
de la loi de la part de certains parquets, en faisant remarquer que les
parquets "doivent tenir compte de l'impact que l'apparition de cannabis
peut avoir dans certaines régions protégées".
Dans l'article, le juge d'instruction d'Evry, monsieur Chausserie-Laprée,
dit à peu près la même chose, c'est-à-dire
qu'en province, la police et la justice sont sous la pression de l'opinion
publique, lorsque l'usage de cannabis se révèle pour la
première fois.[30]
La commission Henrion signale également que les parquets ne mènent
pas une politique uniforme. La politique dépend de fait fortement
du "contexte local", mais la "conviction" personnelle
des procureurs et "leur degré de connaissance" jouent
également un rôle ici.[31]
Par ailleurs, il est ressorti des interviews que les substituts ne sont
pas toujours bien informés du contenu précis des circulaires
ou (par exemple) du fait qu'une circulaire a été retirée
entre temps et remplacée par une autre. La politique en matière
de drogue, telle qu'elle prend forme dans la pratique, dépend de
ce fait en première instance de la politique judiciaire, telle
qu'elle a été formulée par le procureur, utilisant
son pouvoir discrétionnaire.
Dans l'émission de télévision Ça se discute
qui a été diffusée les 7 et 8 novembre 1994, et qui
était entièrement consacrée au débat sur la
dépénalisation, le juge d'instruction Valéry Turcey
a déclaré qu"en ce moment personne en France n'est
emprisonné pour consommation de cannabis (...) car le système
français actuel n'est pas le système tel qu'il est écrit".
Gilles Leclair, directeur de l'OCRTIS s'est exprimé dans des termes
comparables dans la même émission de télévision
: "l'emprisonnement de deux mois à un an pour usage de stupéfiants
n'est plus appliqué que pour les drogues dures et les récidivistes.
Pour le cannabis, le problème est réglé. Nous nous
trouvons actuellement surtout dans un système de déjudiciairisation,[32]
c'est-à-dire, il y a poursuite, mais elle n'est pas forcément
suivie d'une condamnation". Leclair intervint un peu plus tard pour
dire que les principaux cas de condamnation pour détention de cannabis
concernent le trafic dans la rue et la contrebande. "L'usage",
a-t-il dit, "n'est plus poursuivi, car on est dans une déjudiciairisation
de fait".[33]
Le juge d'instruction Turcey a donc affirmé que l'usage de cannabis
n'était plus poursuivi, mais que l'injonction thérapeutique
est toujours appliquée. Les chiffres du Service des Statistiques,
des Etudes et des Systèmes d'Information du Ministère des
Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville, montrent dans combien
de cas l'injonction thérapeutique est appliquée aux consommateurs
du cannabis. En novembre 1993 il s'agissait de 3.617 personnes au total.[34]
Il ressort du "Bilan injonctions thérapeutiques 1994",
que le nombre d'injonctions thérapeutiques appliquées aux
consommateurs de cannabis va en augmentant dans le cadre de la politique
de prévention. Dans certains départements, l'injonction
thérapeutique est rarement appliquée ou ne l'est pas du
tout pour les héroïnomanes, parce que, et c'est l'argument
en vigueur, ils sont rarement arrêtés pour le simple usage
de drogue, mais aussi pour d'autres délits. Dans le département
de la Marne par exemple, 220 injonctions thérapeutiques ont été
prononcées en 1994, mais pratiquement aucune pour des héroïnomanes.
Dans le département de la Moselle, le nombre d'injonctions thérapeutiques
a augmenté de 88 en 1993 à 395 en 1995, dont 72% étaient
des consommateurs de cannabis.
On entend fréquemment en France des déclarations affirmant
que l'usage du cannabis serait dépénalisé, en d'autres
termes ne serait plus sanctionnée, comme celles de Turcey et Leclair
dans l'émission de télévision susmentionnée.
Mais Turcey et Leclair ne sont pas tout à fait dans le vrai, car,
encore une fois, cela dépend entièrement de la politique
définie par le procureur dans sa circonscription.
Bernard Pages, substitut et responsable de la première chambre
du Tribunal de grande instance de Paris (qui s'occupe des affaires concernant
l'usage de drogue), n'est par exemple pas d'accord avec l'assertion que
l'usage de cannabis n'est plus sanctionné.
Pages utilise comme critère le fait que l'usage de drogue est classé
sans suite la première et la deuxième fois, mais que la
troisième fois donne bien lieu à des poursuites, ce qui
entraîne en règle générale le paiement d'une
amende. La détention de drogue, relevant du Nouveau Code Pénal,
est toujours poursuivie, Pages ayant fixé la limite entre consommation
de cannabis et détention de cannabis à environ 30 grammes.
Pages n'applique jamais l'injonction thérapeutique pour l'usage
de cannabis.[35]
La politique en matière de poursuites judiciaires dans la circonscription
du tribunal de Lille est plus libérale qu'à Paris. Le procureur
Olivier Guérin a ici comme politique que l'usage de cannabis n'est
absolument pas poursuivi, tout en définissant, comme son collègue
de Paris, la limite entre usage et détention concernant le cannabis
à environ 30 grammes.[36]
Dans cette circonscription, la situation est encore plus complexe, parce
que la douane y arrête beaucoup de personnes en possession de drogue;
la plupart en provenance des Pays-Bas (le procureur Guérin estime
que 90% de la drogue dans sa circonscription provient des Pays-Bas). En
d'autres termes, étant donné que le tribunal est débordé
par des affaires de drogue, le procureur a instauré des seuils
pour les "transactions douanières". Si la quantité
excède ce seuil, il y a poursuite. Si la quantité de drogue
trouvée est inférieure au seuil, il n'y a pas de poursuite;
la personne en question reçoit seulement une amende de la douane,
qui correspond à environ une fois et demie la valeur dans la rue
de la drogue en France. Ceci est toutefois soumis à un certain
nombre de conditions, notamment que la personne en question puisse présenter
une pièce d'identité, ne soit pas un récidiviste
ou un revendeur et ne soit pas recherché par la police. Les seuils
concernant le cannabis sont de 75 grammes pour le haschich et de 100 grammes
pour la marijuana.[37]
La situation est généralement tout à fait différente
dans d'autres régions. Selon Catherine Vannier du Syndicat de la
Magistrature et employée comme substitut à Laon (département
de l'Aisne), l'affaire de quelqu'un pris avec 20 grammes de cannabis dans
sa circonscription ne sera certainement pas classée. Ensuite, en
cas de comparution, il n'est pas du tout certain que la personne s'en
sorte avec une amende. Il n'est pas exclu, selon les circonstances et
le magistrat qui traite de l'affaire, de voir prononcer une peine de prison
avec sursis de quelques mois.[38]
Les antécédents et "circonstances", tels que le
caractère de la personne et son degré d'insertion sociale
(logement, famille, emploi, études), jouent en pratique un rôle
important dans les considérations du procureur. Mais même
l'application de ces critères n'est pas tout à fait claire.
Pour prendre un exemple : en avril dernier, une étudiante de 20
ans devait comparaître devant le tribunal d'Aurillac (département
du Cantal) pour avoir fumé un joint dans la rue, lors d'un festival.
Manifestement bien intégrée socialement (étudiante),
n'ayant jamais été en contact avec la justice, elle a malgré
tout été condamnée à payer une amende de 5.000
francs.[39]
L'avocat Francis Caballero, également président du Mouvement
pour la Légalisation contrôlée (MLC), mouvement qui
compte de nombreux avocats parmi ses membres, s'occupe déjà
depuis des années de ce genre d'affaires et connaît de nombreux
autres exemples.
Indépendamment du fait de savoir si l'usage de cannabis donne lieu
ou non à des poursuites, le manque de clarté de la limite
entre usage et détention constitue une complication. Ni la loi,
ni les circulaires n'apportent de clarification à ce sujet. La
détention de drogue donne généralement, selon les
circonstances, lieu à des poursuites, car elle est considérée
comme un trafic.
Dans la pratique le procureur détermine la limite entre l'usage
et la détention, mais cette limite est également souple.
Pour prendre un exemple au hasard : vingt grammes de cannabis à
Paris sont assimilés en principe à l'usage. Si ces 20 grammes
ne sont pas constitués d'un seul morceau, mais sont partagés
en plusieurs parts, il y a un risque important que ce soit considéré
comme une détention, et que la personne soit poursuivie.
Il se peut également qu'une personne qui est interpellée
avec une quantité de cannabis plus importante, achetée pour
son usage personnel et pour des amis pour des raisons économiques
(achat en gros), soit considérée comme un trafiquant, même
si elle ne l'a pas fait par amour du gain. La condition liée à
l'usage de drogue est que la quantité destinée à
la consommation personnelle soit plausible. Il arrive également
que quelqu'un, dont on sait ou que l'on suppose être un dealer,
soit poursuivi sur la base d'une petite quantité de cannabis. On
n'a alors pas pu l'attraper avec de plus grandes quantités sur
lui, et on le poursuit pour "usage de drogue" à défaut
d'autres preuves.
Il est impossible de trouver des chiffres au niveau national sur le nombre
de condamnations pour usage de cannabis, parce que la loi ne fait pas
de distinction entre les sortes de drogues. Par contre, on peut trouver
des chiffres sur le nombre d'infractions à la loi sur les stupéfiants,
ensuite sur le nombre de cas où il s'agit d'usage de drogue, et
enfin le nombre de cas où une infraction à la législation
sur les stupéfiants a été suivie d'une condamnation.
Il ressort d'une étude récente d'Odile Timbart du Ministère
de la Justice qu'en 1991, 42.009 "infractions à la législation
sur les stupéfiants"(ILS) ont été sanctionnées
par 22.699 condamnations.[40]
Timbart remarque que la justice française consacre en moyenne 5%
de ses activités à ces infractions. Les "stupéfiants"
arrivent au troisième rang après le vol et la conduite en
état d'ivresse (qui représentent tous deux 25%).
Parmi les 42.009 infractions citées, les délits les plus
fréquents concernent la détention/l'acquisition de drogue
avec 38,8% et l'usage de drogue avec 27,4%. Suivent ensuite la détention
(15%), le transport (10,5%) et le trafic de drogue (6,7%).
Les 22.699 condamnations pour ILS qui ont été prononcées
en 1991 sur la base des 42.009 infractions, l'ont été dans
70% des cas sur la condamnation de plusieurs délits (infractions
multiples). Quand la condamnation sanctionne plusieurs infractions, le
trafic est souvent cité en premier. De fait, la cession, le transport
et la détention-acquisition sont cités à la fois
en premier, second ou troisième délit. L'usage de stupéfiants
est plus souvent cité, pour ces condamnations, comme deuxième
délit que comme premier. Par contre, parmi les 30% restants des
condamnations fondées sur un seul délit, l'usage de drogue
est le délit le plus courant : il représente 61% de ces
condamnations.
Dans 86% des 22.699 condamnations citées il a été
prononcé une peine d'emprisonnement (37% ferme, 12% avec sursis
partiel, 37% avec sursis). Lorsque l'usage de drogue constituait un des
délits ou était le délit à l'origine de la
condamnation (pour 11.505 des 22.699 condamnations), la peine s'est avérée
un peu plus légère, car cela a donné lieu à
une peine de prison pour 80% des condamnations (9166 dont: 28% ferme,
10% avec sursis partiel, 41% avec sursis).
Parmi les ll.505 condamnations dont l'usage de drogue constituait un des
délits ou était le délit à l'origine de la
condamnation, l'usage de drogue était dans 37% (4.242) des cas
le seul délit de l'inculpation. Cela signifie donc qu'en 1991,
4.242 personnes ont été condamnées pour ce délit.
Parmi ces condamnations, 67% des cas ont donné lieu à une
peine d'emprisonnement (24% ferme, 1% avec sursis partiel, 41% avec sursis).
Bernard Leroy, employé au PNUCID des Nations Unies, a fait observer
à la suite des constatations de Timbart, que si de nombreux usagers
de drogue se voient infliger une peine de prison, c'est parce qu'ils font
défaut. Dans de nombreux cas, affirme Leroy, l'usager ne purge
pas sa peine.[41]
Annie Kensey et Jean-Paul Jean ont essayé dans un article, de déterminer
combien d'usagers de drogue ont vraiment effectué une peine de
prison pour le délit `usage de stupéfiants'.[42]
Ils apportent un peu de clarté aux chiffres, mais parviennent finalement
à la conclusion qu'il est impossible de le déterminer.
Sur la base des chiffres cités, on a pu se faire une idée de la politique de poursuite concernant les infraction à la législation sur les stupéfiants, parmi lesquelles l'usage de drogue, au cours de l'année 1991. Mais le point de départ de Timbart était la condamnation, et non le délit. Ses données ne disent donc rien sur les infractions qui ont été classées, sans parler de l'existence d'une plus grande clarté concernant la politique de poursuite de l'usage de cannabis.
Marie-Danièle Barré, chercheur au Centre de Recherches
Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP),
le centre de recherche du Ministère de la Justice, a pris les procès-verbaux
comme point de départ d'une étude.[43]
Il ressort entre autres de son étude que le (simple) usage de cannabis
entraîne rarement une poursuite et une condamnation. Lorsqu'il y
a poursuite, c'est parce qu'il y a des antécédents.
Cette étude est cependant "limitée" par le fait
qu'elle concerne Paris et la petite couronne (départements 92,
93, 94). Dans l'agglomération parisienne, il est donné,
en pratique, une priorité plus faible aux recherches en matière
d'usage de cannabis (la priorité étant donnée au
trafic de drogue et à l'usage de drogue dure). Les résultats
de cette étude ne sont donc certainement pas représentatifs
pour la France entière.
La politique de la police et de la gendarmerie
Le pouvoir exécutif est constitué de la police et de la
gendarmerie; la première dépend du Ministère de l'intérieur,
la seconde du Ministère de la Défense. La règle est
que l'activité de la police concerne les communes à partir
de 10.000 habitants; celle de la gendarmerie le reste du pays. La gendarmerie
exerce ainsi son autorité sur 80% du territoire français,
ce qui revient à environ la moitié de la population totale.
Aussi bien la police que la gendarmerie alignent leur politique sur celle
du procureur relative aux poursuites.
Même si l'usage de cannabis ne donne plus toujours lieu, loin s'en
faut, à des poursuites, cela n'empêche pas que les gens sont
toujours interpellés pour cela. L'idée générale
qui sous-tend l'interpellation d'usagers de drogue est que cela permet
de remonter les réseaux de la drogue : en interrogeant l'usager,
on arrive au petit trafiquant, qui permet de remonter au gros trafiquant,
etc...
Les chiffres de l'OCRTIS montrent combien de personnes ont été
interpellées pour usage de drogue par la douane, la gendarmerie
et la police. Les statistiques ne font toutefois pas la distinction entre
usage et usage-revente.
On verra d'abord les chiffres des années 1979, 1984 et 1989. Cela
donne une idée de l'évolution à plus long terme.
Les chiffres plus récents des cinq dernières années
seront présentés ensuite.
Le nombre d'interpellations pour usage et usage-revente de cannabis au
cours des dernières années s'est élevé à
(entre parenthèses se trouve le taux d'interpellations pour usage
et usage-revente de cannabis par rapport au nombre total d'interpellations
pour usage et usage-revente de drogue) :
- 1979 : 5.342 (63%)
- 1984 : 14.479 (58%)
- 1989 : 18.544 (63%)
Les chercheurs Marialuisa Cesoni et Michel Schiray ont cité ces
chiffres dans un article datant de 1992 sur la "situation de la drogue"
en France.[44]
Il est clair que les interpellations pour usage de cannabis ont beaucoup
augmenté de 1979 à 1989.
Cesoni et Schiray notent à ce sujet que, soit ces chiffres contredisent
les déclarations des agents de police qui disent avoir une attitude
plus souple à l'égard de l'usage de cannabis, soit l'usage
de cannabis a augmenté plus fortement que celle de l'héroïne.
Il ressort de chiffres plus récents que le nombre de consommateurs
de cannabis qui ont été interpellés ces dernières
années, fluctue autour de 30.000. Il s'agit ici aussi du nombre
d'interpellations pour usage et usage-revente de cannabis (entre parenthèses
: le pourcentage de cannabis par rapport au nombre total d'interpellations
pour usage et usage-revente de drogue) :
- 1991 : 27.928 (70%)
- 1992 : 32.179 (66%)
- 1993 : 28.351 (63%)
- 1994 : 32.686 (62%)
Parmi les 32.686 personnes qui ont été interpellées
en 1994 pour usage et usage-revente de cannabis, il s'agissait dans 80%
des cas d'usage de cannabis (et donc dans 20% d'usage-revente).[45]
La première conclusion qu'on peut en tirer est qu'une partie considérable
des personnes interpellées pour infraction à la législation
sur les stupéfiants est constituée de consommateurs de cannabis.
Une "interpellation" implique la rédaction d'un procès-verbal.
Les chiffres présentés indiquent donc des gens qui ont fait
l'objet d'un procès-verbal. Cela implique que quelqu'un, qui est
interpellé par la police (la sécurité publique),
est emmené au commissariat où il doit ensuite se rendre
au service de la police judiciaire. Une interpellation implique également
que la personne soit interrogée et soit mise en garde à
vue. Ceci revient à un séjour en cellule de quelques heures
ou d'une nuit entière.
Dans la pratique, le nombre de consommateurs de cannabis qui sont interpellés
(au sens large du mot) et emmenés au commissariat dépasse
celui que montrent les chiffres susmentionnés, car il n'y a pas
par définition de rédaction d'un procès-verbal. Lorsqu'il
s'agit, aux yeux de la police judiciaire, d'un petit délit (ce
qui dépend entre autres des "circonstances"), cela est
noté dans un registre du commissariat :"la main courante".
Une fois consigné dans le registre et après signature de
la personne, celle-ci peut s'en aller. Etant donné que la main
courante est un registre manuscrit pour un seul commissariat et qu'il
n'existe pas de système informatisé, la personne n'est enregistrée
nulle part ailleurs et cela ne signifie donc pas grand chose pour elle
dans la pratique. Il peut ainsi se produire qu'une personne soit inscrite
plusieurs fois dans la main courante. C'est à la police judiciaire
de considérer, au bout de combien d'inscriptions dans la main courante,
il faut dresser un procès-verbal et en informer le procureur.
La situation est un peu plus complexe dans la région parisienne.
Elle dispose en effet d'une police judiciaire centrale pour les drogues,
la Brigade de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants
(BRTIST), désignée communément par la Brigade des
stupéfiants. Cette brigade intervient à Paris et dans la
petite couronne.
Lorsque la police arrête quelqu'un dans la région parisienne,
ce n'est pas la police judiciaire "ordinaire" qui se penche
sur l'affaire, mais la brigade des stupéfiants. En principe, les
affaires concernant des drogues qui ont lieu dans la région parisienne
sont traitées ici : le procès-verbal y est dressé
et l'usager y est mis en garde à vue.
En 1990, 8.200 affaires d'usagers de drogue ont été "traitées"
par la Brigade des stupéfiants. Dans 5.500 des cas sur les 8.200
il y a eu procès-verbal, 3.200 ont été expédiés
en tant que main courante.[46]
Marie-Danièle Barré a étudié dans son rapport
les motifs d'expédition d'affaires à titre de main courante.
La mention "suspicion de cannabis" ou "arnaque" figure
parfois dans la main courante. En d'autres termes : un agent de police
suppose avoir trouvé du cannabis chez quelqu'un, il remet le suspect
à la Brigade des stupéfiants, qui s'aperçoit après
"inspection" plus approfondie qu'il ne s'agit pas de "vraie"
drogue, mais d'arnaque (le suspect aurait donc été berné
et aurait acheté de la drogue "bidon"). Sur un petit
échantillon, constitué de 102 personnes, que Barré
a pris dans la main courante, il s'est avéré que dans 89
cas la police avait qualifié le produit trouvé de haschich
ou de marijuana, mais que la Brigade des stupéfiants n'a repris
cette qualification que dans 37 cas.[47]
Il est évident que la Brigade des stupéfiants ne soumet
pas chaque quantité de cannabis à un examen. Souvent la
quantité est supposée trop petite pour être considérée
comme de la "vraie" drogue.
Une personne qui enfreint la législation sur les stupéfiants
et est interpellée à Paris ne se retrouve pas dans tous
les cas à la Brigade des Stupéfiants. En effet, lorsque
la police judiciaire interpelle elle-même quelqu'un, la personne
en question n'est pas amenée à la Brigade des stupéfiants,
et la police judiciaire règle l'affaire elle-même.
La police judiciaire parisienne applique comme limite supérieure
pour la main courante, selon les "circonstances", une quantité
de cannabis d'environ 5 à 10 grammes.[48]
Des quantités plus importantes de cannabis sont considérées
comme le délit "usage de stupéfiants". Dans ce
cas, un procès-verbal est dressé et le procureur en est
informé ultérieurement.
La police judiciaire parisienne donne une nette priorité à
la recherche de trafic de drogue et à l'usage de drogue dures.
Cela est particulièrement évident dans par exemple le 18ème
arrondissement de Paris, un arrondissement où il y a beaucoup d'usage
et de trafic de drogue. Etant donné que le trafic concerne ici
l'héroïne et de grandes quantités de cannabis (centaines
de grammes ou kilos), la police n'interviendra pas si vite si quelqu'un
fume discrètement du cannabis dans la rue.
Bien qu'il n'existe pas de directives qui prescrivent que la police n'est
pas obligée d'intervenir lorsqu'elle constate l'usage de cannabis,
cela arrive cependant dans la pratique. Si le consommateur de cannabis
a de la chance, l'agent de police fait semblant de n'avoir rien vu. Une
autre possibilité pour l'agent de police est de demander l'identité
de la personne et (peut-être) de saisir ou jeter le cannabis. En
fait, la situation n'est absolument pas claire et l'on dépend avant
tout de l'agent de police en question. D'après ce que l'on raconte,
les commissaires sont plus "faciles" que les agents.
En pratique, plusieurs facteurs influent les éventuelles démarches
de l'agent de police. Tout dépend du lieu d'interpellation de la
personne, de sa façon de répondre, si sa tête (ou
la couleur de sa peau) plaît à l'agent de police, etc...
Les consommateurs de cannabis se plaignent fréquemment du fait
que la police a toujours la possibilité d'en faire "grand
cas" ("s'ils veulent t'attraper"), car selon la loi tout
usage et détention est délictueux.
La gendarmerie a une politique un peu différente de la police.
D'abord elle ne travaille pas avec le système de main courante.
Les directives de la Direction Générale de la gendarmerie
prescrivent en effet que pour chaque infraction, un procès-verbal
doit être dressé et le procureur doit en être informé.
Cela vaut donc également pour chaque infraction à la législation
sur les stupéfiants, comme l'usage de cannabis.[49]
En outre, la gendarmerie, contrairement à la police notamment dans
les grandes villes, ne fait pas non plus de distinction entre les différentes
sortes de drogues. D'après la gendarmerie, il existe en effet une
relation importante entre la criminalité et l'usage de drogue,
quelle que soit la sorte de drogue (donc également le cannabis).
Il s'avère en effet que chaque fois qu'on remonte un réseau
de drogue, cela entraîne une baisse de la criminalité, ce
qui permet de démontrer la nécessité d'une lutte
contre tout usage de drogue.
La législation ne peut donc pas faire la distinction entre les
différentes sortes de drogue, mais dans la pratique la police le
fait assez couramment, notamment dans les grandes villes ou les régions
urbaines; elle situe nettement ses priorités sur la recherche au
niveau du trafic de drogue et de l'usage de drogue dure.
Dans le rapport statistique annuel de la police judiciaire, il est même
indiqué implicitement qu'il existe une sorte de hiérarchie
au sein des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le rapport mentionne en effet que les faits moins graves d'usage de drogue
ne sont pas transmis à l'OCRTIS (ceci pour expliquer la différence
entre les chiffres de l'OCRTIS et de la police judiciaire).
L'existence d'une priorité à la recherche des drogues apparaît
également nettement dans la lecture des chiffres de l'OCRTIS. Etant
donné qu'il y a beaucoup plus de consommateurs de cannabis que
d'héroïnomanes, le nombre d'interpellations de consommateurs
de cannabis devrait être beaucoup plus important que celui d'héroïnomanes,
en cas de respect strict de la loi. (Encore une fois, une interpellation
équivaut ici à la rédaction d'un procès-verbal).
A l'échelle nationale c'est d'ailleurs certainement le cas (en
1994, 32.179 interpellations pour du cannabis et 14.577 pour de l'héroïne),
bien que la proportion cannabis-héroïne ait bien changé
de ce point de vue, au cours de ces dernières années. S'il
y avait encore en 1991 2,6 fois plus d'interpellations de consommateurs
de cannabis que d'héroïnomanes, ce facteur est descendu à
2,2 en 1992 et à 1,8 en 1993. En 1994, ce facteur a de nouveau
augmenté jusqu'à 2,2.
Cette évolution est encore plus évidente au niveau régional.
A ce niveau le nombre d'interpellations d'héroïne est parfois
supérieur à celui de cannabis. Cela a été
le cas en 1994 par exemple pour les départements des Ardennes,
de la Moselle, du Nord, du Bas Rhin, du Haut Rhin, d'Ile de France et
de l'Essonne. Dans plusieurs autres départements le nombre de consommateurs
de cannabis interpellés est à peine plus élevé
que celui d'héroïnomanes, à savoir : les Alpes Maritimes,
les Bouches du Rhône, la Haute Garonne et le Pas de Calais.
Si l'on compare ces chiffres de l'OCRTIS de 1994 à (par exemple)
ceux de 1992, on s'aperçoit qu'il n'y avait qu'un seul département
en 1992, les Bouches du Rhône, où les interpellations d'héroïne
dépassait celles de cannabis. Dans les département du Nord
et de Paris, où le nombre d'interpellations d'héroïne
dépassait celui de cannabis, la situation était encore tout
à fait différente en 1992; les interpellations de consommateurs
de cannabis étaient alors nettement supérieures en nombre.
La seule explication possible est que la tolérance à l'égard
du cannabis a augmenté au cours de ces deux années.
Tout bien considéré, la mise en oeuvre de la politique
en matière de drogue manque totalement de clarté dans la
pratique. Alors qu'une même personne qui consomme du cannabis n'a
rien ou peu à redouter à un endroit, elle sera arrêtée
pour la même chose à un endroit différent. Le rapport
Henrion signale lui aussi qu'il existe de telles différences, notamment
en ce qui concerne l'usage de cannabis. Le rapport indique qu'une tolérance
grande ou faible de la part de la police en matière de consommation
de cannabis peut varier d'un quartier à l'autre.[50]
En cas d'interpellation, il est difficile de savoir ce qui va se passer
: peut-être la main courante, peut-être un procès-verbal
et une nuit passée dans une cellule, et éventuellement un
coup de fil au substitut qui décidera (peut-être) de procéder
aux poursuites.
Devant tant de différences d'application de la "politique
en matière de drogue" dans la pratique, il est question pour
les personnes qui la critiquent d'une inégalité juridique
totale. La majorité de la commission Henrion a déclaré
qu'il n'est pas souhaitable qu'une loi soit appliquée de manière
si différente.