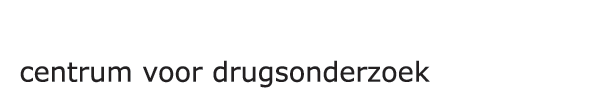Boekhout van Solinge,
Tim (1996), Le cannabis en France. In: Peter Cohen & Arjan Sas (Eds.)
(1996), Cannabisbeleid in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Amsterdam: Centrum voor Drugsonderzoek, Universiteit van Amsterdam. pp.
162-170.
© Copyright 1995 Tim Boekhout
van Solinge. All rights reserved.
5. Le débat sur la situation actuelle
Tim Boekhout van Solinge
Il a déjà été dit dans l'introduction que la situation actuelle donnait lieu à de nombreuses discussions depuis un an ou deux. Il n'existe pratiquement pas de discussion sur la légalisation. Le débat concerne presque toujours la dépénalisation de l'usage du cannabis, ce qui signifie que l'usage du cannabis ne doit plus être sanctionné. Il faut donc distinguer cette notion de celle de la légalisation, qui signifie que le produit `cannabis' devient légal.
Le secteur de la justice et de la police
Comme nous l'avons déjà vu, la loi du 31 décembre
1970 sanctionne tout usage de drogue. Cette loi correspond à un
renforcement de la politique en matière de drogues, car avant 1970
son usage était seulement puni s'il avait lieu en société.
L'usage solitaire en privé n'était pas sanctionné
jusqu'alors.
Le législateur a justifié cette législation plus
sévère de 1970 en alléguant qu'à une époque
où le droit à la santé et aux soins est progressivement
reconnu à l'individu, en particulier par la généralisation
de la sécurité sociale et de l'aide sociale, il est normal
qu'en contrepartie la société puisse imposer certaines limites
à l'utilisation que chacun peut faire de son propre corps, surtout
lorsqu'il s'agit de substances dont les spécialistes dénoncent
unanimement l'extrême nocivité".[51]
La loi du 31 décembre 1970 a donné lieu à de nombreuses
critiques. Le législateur avait essayé avec cette loi de
rechercher la solution au problème de la drogue en associant répression
et assistance. Le fait que la loi soit dépassée et ne s'applique
plus à la situation actuelle constitue un point de critique.
Yann Bisiou a récemment écrit à ce sujet d'un compromis
impossible et une tentative de réunir l'eau et le feu :"(...)
cette loi est un colosse aux pieds d'argile. Enfermée dans ses
contradictions, elle ne parvient pas à répondre aux problèmes
d'usage et de trafic de stupéfiants. Les interpellations, les saisies
sont de plus en plus nombreuses, témoignant, selon les services
de la gendarmerie, de la police ou des douanes, d'un accroissement des
consommations. Les moyens dont sont dotés ces mêmes services
répressifs remettent en cause les libertés individuelles
sans pour autant apporter la moindre esquisse de solution".[52]
Deux ans auparavant, en 1992, était parue une étude critique
sur la loi du 31 décembre 1970 de Jacqueline Bernat de Célis.[53]
Dans son étude, non seulement elle dénonce le principe de
la loi (faut-il vraiment considérer l'usage de drogue comme un
délit?), mais elle montre également dans quelles circonstances
fantomatiques la loi a traversé l'Assemblée Nationale française
et à quel point l'application de la loi est incohérente.
Les critiques de la législation sur la drogue émanent également
d'autres sources. L'avocat et professeur d'université Francis Caballero
est un des plus grands détracteurs (en tout cas le plus connu)
de la législation actuelle. Caballero est également le fondateur
et président du Mouvement pour la Légalisation Contrôlée
(MLC), un mouvement auquel un nombre croissant d'avocats se sont affiliés.
Le noyau de la critique du MLC est que la législation sur les stupéfiants
est en opposition avec l'article 4 de la Déclaration des droits
de l'homme. Si ces idées n'étaient pas prises très
au sérieux au départ, elles sont mieux accueillies actuellement.
(Caballero est d'ailleurs un invité populaire des programmes de
télévision.)
Le Syndicat de la Magistrature (SM), le syndicat de gauche qui représente
à peu près 30 à 35% de la magistrature, a déclaré
à l'occasion de son congrès annuel de novembre 1993 "être
convaincu de la nécessité de modifier la loi du 31 décembre
1970". Le congrès a mandaté le conseil pour réfléchir
à un système de légalisation contrôlée
des stupéfiants. Le congrès s'est également prononcé
pour une dépénalisation de l'usage de stupéfiants
en privé, si cela ne porte pas préjudice à des tiers.[54]
Du côté de l'appareil judiciaire, on ne trouve probablement
pas autant d'opposants à la politique actuelle. Comme on vient
de le dire, le Syndicat de la Magistrature (SM) s'est effectivement prononcé
pour une modification de la politique, mais ce syndicat représente
une minorité d'environ 30 à 35%. Le syndicat de la magistrature
le plus important, l'Union Syndicale des Magistrats (USM), est plus conservateur
et n'est probablement pas partisan de modifications radicales de la politique
actuelle. Le troisième syndicat de la magistrature, l'Association
Professionnelle des Magistrats (APM) est plus à droite (d'extrême
droite selon certains) que l'USM, et il est donc exclu que l'APM soit
partisane de changements.
Par contre, Jean-Paul Jean, magistrat, Inspecteur des Services Judiciaires,
responsable de l'enseignement en matière de stupéfiants
à l'Ecole Nationale de la Magistrature et ancien conseiller de
différents Ministres (socialistes) des Affaires Sociales, voit
de nombreux problèmes dans la législation actuelle.[55]
Le fait que la loi ne fasse pas de distinction entre les drogues, et de
ce fait, les gens non plus, constitue à ses yeux le problème
majeur. L'autre problème est la répartition en drogues légales
et illicites : il est autorisé d'associer de l'alcool et du rohypnol,
mais il n'est pas autorisé de consommer du cannabis. Aussi Jean
voit-il un fossé important entre le Ministère de l'Intérieur,
la police et la magistrature d'une part et la jeunesse d'autre part. L'appareil
répressif n'est pas en contact avec la jeunesse et se maintient
en luttant contre l'usage de drogue. S'ajoute à cela le fait que
le Ministère de l'Intérieur et la police qui en fait partie,
peuvent obtenir des succès ou résultats faciles avec la
drogue, comme en matière des interpellations d'immigrés
clandestins (deux motifs importants pour contrôler les gens).
Jean, qui assure également la formation continue sur les stupéfiants
pour les magistrats, observe que la magistrature connaît une importante
lacune de connaissance en matière de drogue, mais dans le même
temps il y voit une évolution positive avec l'arrivée d'un
grand nombre de jeunes magistrats.
Dans la police, on entendra peu d'échos souhaitant la dépénalisation
du cannabis. Comme on l'a déjà constaté, la police
s'y oppose, son point de vue étant favorable à une interpellation
des usagers de drogue dans le but de remonter les réseaux (d'en
bas jusqu'en haut). Par ailleurs, elle dit parfois qu'il n'est pas nécessaire
de dépénaliser puisque cela se fait déjà dans
la pratique.
Michel Bouchet, chef de la Brigade des stupéfiants et Gilles Leclair,
chef de l'OCRTIS, sont en tout cas des opposants prononcés d'une
politique plus libérale en matière de drogue. On a pu suivre
quelque peu leurs points de vue au cours de la période pendant
laquelle la Commission Henrion s'est penchée sur la problématique
de la drogue, car aussi bien Bouchet que Leclair faisaient partie de la
Commission dont une partie des discussions semblait parfois se dérouler
davantage dans la presse qu'au sein de la Commission (voir la suite de
ce chapitre au sujet de la commission).
Ce que l'on entend aussi bien dans le secteur de la justice que dans celui
de la police, c'est qu'en France on aime les lois écrites. Même
si l'on sait que la loi n'est pas toujours observée, on préfère
s'attacher à l'existence d'une loi plutôt que d'adapter la
loi à la pratique.
Il est impossible en France de trouver des données concernant les frais de l'appareil répressif. La seule donnée ferme a déjà été citée dans le chapitre 4, notamment le fait que la justice française consacre, d'après Odile Timbart, en moyenne 5% de ses activités aux infractions à la législation sur les stupéfiants, et que les stupéfiants arrivent ainsi au troisième rang après le vol et la conduite en état d'ivresse (tous deux 25%). On pourrait éventuellement calculer combien coûte la prison par personne et par jour, mais étant donné qu'on ne sait pas combien de personnes sont emprisonnées pour usage de drogue, sans parler du cannabis, cette donnée est inutilisable. Une autre donnée dont on dispose est le budget de la Délégation Générale à la Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (DGLDT), qui s'élevait en 1993 à environ 200 millions de Francs.
Le secteur médical
Les entretiens avec différents médecins donnent l'impression
que le monde médical n'est généralement pas partisan
d'une politique plus libérale en matière de drogue. Par
contre, la plupart des médecins qui travaillent dans le secteur
des soins en sont partisans.
D'après Patrick Aeberhard, président honoraire de Médecins
du Monde, les médecins adoptent en France un point de vue conservateur
dans le domaine du cannabis. Cela est dû en premier lieu au fait
qu'il n'ont reçu aucune formation à ce sujet. Ils n'apprennent
rien sur le cannabis et ses effets au cours de leurs études.[56]
On attache beaucoup de valeur à la psychanalyse en France. Même
dans le domaine de la drogue, on y entend assez souvent des explications
psychanalytiques sur le phénomène de l'usage de drogue.
L'usager de drogue est considéré comme quelqu'un qui a eu
des problèmes dans sa jeunesse et espère pouvoir compenser
ce manque, ou tout au moins atténuer sa douleur, en prenant de
la drogue. On retrouve, par exemple, plus ou moins cette théorie
dans le Rapport Pelletier de 1978. Monique Pelletier a rédigé
en 1978 un rapport sur les problèmes de la drogue, à la
demande du Président Giscard d'Estaing. Une de ses recommandations
était de faire une distinction entre le cannabis et les autres
drogues (ce qui a constitué la base de la circulaire du 17 mai
1978). Le cosommateur de cannabis ne doit pas être considéré
comme un toxicomane, mais comme un jeune en danger.[57]
L'usage de drogue a ainsi été ramené à un
problème personnel de l'individu et, si l'on pousse ce raisonnement
plus loin, on ne peut pas en imputer la responsabilité à
la société.
On entend également assez souvent professer la théorie de
l'escalade en France : l'usage de drogues douces mene à l'usage
de drogues dures. Bien que cette théorie fait, il est vrai, moins
recette actuellement, on lit et on entend encore régulièrement
des théories du type : `bien que tous les fumeurs de cannabis ne
deviennent pas héroïnomanes, il apparaît que presque
tous les héroïnomanes ont commencé par le cannabis'.
Le fait qu'il existe toujours une discussion sérieuse sur la théorie
de l'escalade montre qu'elle n'a pas tout à fait disparue de la
scène.
Il n'est pas possible d'entendre le débat au sein du monde médical
français sans tenir compte de Gabriel Nahas. Ce médecin,
dont il a déjà été question dans le chapitre
3, est l'un des plus grands opposants à une politique libérale
en matière de drogue. Nahas écrit par exemples des livres
tels que "Il n'y a pas de drogues douces" et des articles dans
lesquels il veut démontrer l'effet de dépendance du cannabis
ou son effet ravageur sur le cerveau. Nahas a une position assez controversée
au sein du monde médical. Certains médecins, comme Bertrand
Lebeau de Médecins du Monde, l'ont accusé de procéder
de manière non scientifique (après quoi Nahas a entrepris
des démarches en justice). Il est certain que les conceptions scientifiques
de Nahas sont teintées idéologiquement et qu'il professe
un point de vue minoritaire au sein du monde médical. Nahas a occupé
longtemps une position assez dominante dans le sens où les politiciens
ont aimé le prendre comme référence ou l'inviter
en tant qu'expert. Ainsi Jacques Chirac a eu, pendant un temps, Nahas
comme conseiller (informel), alors qu'il était maire de Paris ainsi
que pendant la période où il était premier ministre
(1986-1988).
La municipalité de Paris et l'Académie Nationale de Médecine
ont organisé les 8 et 9 avril 1992 un congrès scientifique
consacré à la drogue. Nahas faisait partie du comité
d'organisation scientifique; la préface du recueil rédigé
à l'occasion du congrès était de la main de Jacques
Chirac. On y lit entre autres :
"Les conclusions de cette prestigieuse Assemblée sont sans
équivoque : la toxicité du cannabis est aujourd'hui bien
établie, en particulier pour le système nerveux central.
Sa consommation conduit inéluctablement bon nombre d'usagers vers
la cocaïne ou l'héroïne. En conséquence, il convient
de récuser la distinction entre drogues dites "douces"
et drogues dites "dures" et de rejeter toute idée de
libéralisation de l'usage de cette substance en développant
parallèlement des campagnes d'information et de prévention
sur les dangers qu'elle représente".[58]
En effet, les conclusions générales du congrès, signées dans le recueil du colloque par le Professeur Henri Baylon de l'Académie Nationale de Médecine, étaient les suivantes :
- La toxicité du cannabis est aujourd'hui bien établie, en particulier pour le système nerveux central.
- Bon nombre de consommateurs de cannabis deviennent un jour usagers de cocaïne ou d'héroïne.
- Des études épidémiologiques ont démontré que l'usage de drogue dures ne se produit que rarement chez des personnes qui n'ont jamais consommé de cannabis.
- En conséquence, les participants au congrès rejettent la distinction entre drogues dites "douces" et drogues dites "dures".
- Dans les endroits où il y a eu une libéralisation de l'usage du cannabis, on a assisté à une augmentation considérable de la consommation et des accidents qu'elle a entraîné.
- Il est important de développer des programmes d'information et de prévention au sujet de la légalisation et de ses effets sur la consommation de cannabis.
Aujourd'hui Nahas et ses partisans ont perdu la position dominante qu'ils occupaient. Des points de vue de ce genre sont désormais considérés comme ultra conservateurs. Depuis quelques années, les débats sur le cannabis ont beaucoup changé, ce qui ne veut pas dire que les idées qui dominaient auparavant, aient totalement disparu. Mais on peut affirmer que l'ensemble de la discussion a pris une autre tournure et qu'on peut parler désormais d'une réelle discussion. Alors que le sujet de la drogue était auparavant soumis à un tabou important.
Le problème du cannabis (ou de manière générale
le problème de la drogue) est parfois mis en relation avec le problème
de l'alcool, du tabac et des médicaments en France. Il a déjà
été mentionné que les Français sont les plus
gros consommateurs d'alcool du monde, mesuré en nombre de litres
d'alcool pur par personne et par an.
Il est frappant que les Français l'emportent également dans
le domaine de la consommation de médicaments. La consommation pharmaceutique
en France est presque le double des pays considérés comme
de gros consommateurs, comme les Etats-Unis et l'Allemagne, et le triple
par rapport à des pays de consommation modérée comme
le Royaume Uni et les Pays-Bas.[59]
Etant donné que les dégâts dûs à la consommation
d'alcool et de tabac, du point de vue de la santé publique, sont
bien supérieurs à ceux dûs à l'usage de drogue,
les opposants à la politique actuelle en matière de drogue
utilisent cet argument pour démontrer que la politique francaise
est hypocrite.
Les partisans de la politique actuelle emploient le même argument
: nous avons déjà suffisamment de problèmes avec
les drogues légales actuelles, alors pourquoi en ajouter encore
une autre en dépénalisant le cannabis. On dit souvent à
ce sujet que l'esprit latin n'est pas aussi discipliné que l'esprit
nordique.
Le débat sur la dépénalisation
Charles Pasqua, Ministre de l'Intérieur, a annoncé en juin
1993 qu'il fallait qu'il y ait un grand débat sur la dépénalisation
du cannabis, parce que la loi ne serait plus appliquée. Ce n'était
pas "par faiblesse pour ces idées utopiques (...) mais, à
l'inverse, pour qu'éclate au grand jour ce que je considère
comme une mystification (...) Il n'y a pas de drogues moins "dures"
que d'autres".[60]
L'explication générale de la déclaration de Pasqua
est qu'il s'inquiétait de ce que la loi n'aurait plus été
appliquée. Certains fonctionnaires de police auraient été
trop tolérants à l'égard de l'usage du cannabis.
Des voix se seraient élevées au sein de la police pour douter
de l'utilité de la politique en matière de drogue. La déclaration
de Pasqua aurait été une réaction à cette
tendance.
Le point de vue de Pasqua au sujet de la drogue est clair. Il l'a encore
expliqué lors de l'émission de télévision
Envoyé spécial, diffusée sur France 2 le 27
janvier 1994. L'émission était entièrement consacrée
à la drogue, et Pasqua était invité pendant toute
l'émission à commenter les reportages. A la question de
savoir s'il fallait faire une distinction entre les drogues dures et douces,
Pasqua a répondu : "Non, pour une raison simple. Si vous
posez cette question, c'est qu'elle en sous-tend une autre, c'est-à-dire
s'il faut dépénaliser l'usage du haschich. Je suis contre,
car quand je discute avec des spécialistes, comme de grands professeurs
de médecine, ils me disent qu'il n'existe pas de drogues douces,
et qu'il y a notamment dans le haschich des substances qui sont extrêmement
toxiques. D'autre part j'estime qu'il n'y a pas de toxicomanes aux drogues
dites dures, qui n'ont pas commencé par ce qu'on appelle parfois
les drogues douces (...) Ce qu'il y a de plus dangereux dans la consommation
de haschich, c'est que sans que l'on se rende compte elle contamine et
elle incite à se droguer".[61]
Abstraction faite des idées de Pasqua, ce débat a effectivement
eu lieu, depuis le moment où il l'a lancé, notamment en
ce qui concerne le cannabis.
L'Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie (ANIT), une instance
renommée qui réunit environ 500 intervenants en toxicomanie,
a organisé les 27 et 28 mai 1994 un congrès à Bordeaux,
intitulé "Drogues et interdits : l'esprit des lois".
L'ANIT a déclaré a l'occasion de ce congrès être
partisane de la dépénalisation de l'usage de toutes les
drogues et d'une légalisation contrôlée du cannabis.
L'ANIT est généralement une instance très respectée,
même dans les hautes sphères du gouvernement. Différentes
personnes haut placées assistaient au congrès de l'ANIT,
notamment le directeur de l'époque de la Délégation
Générale à la lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
(DGLDT), Jean-Louis Langlais, qui a également prononcé le
discours d'ouverture du congrès.
En novembre 1994, le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE)
a publié un rapport sur la politique en matière de drogue.
Sa conclusion était entre autres que la politique actuelle (de
répression) ne constituait pas la bonne réponse au problème
de la drogue. La distinction entre drogue légale et illicite, sur
laquelle se base la politique de répression, est dépassée
à la fois par la science et par la pratique. Le Comité propose
par conséquent une nouvelle classification des drogues, basée
sur d'autres critères que ceux en vigueur.
Le Comité a estimé qu'une légalisation des drogues,
qui sont encore illicites, irait trop loin, parce qu'elle pourrait éventuellement
entraîner une augmentation de l'usage parmi les jeunes. Le Comité
propose une troisième voie, qui rend compatible une sécurité
suffisante avec une liberté maîtrisée. Cela devrait
avoir lieu sous une réglementation claire, comprenant un "contrôle
du produit" et un "accès contrôlé"
au produit.
En mars 1994, Simone Veil a instauré la Commission Henrion ("la
commission des sages"). Cette commission devait se pencher sur le
problème de la drogue et de la toxicomanie. La constitution de
la commission a pris beaucoup de temps, parce que toutes les "parties"
devaient être représentées (comme la police, la santé,
la science, les media etc.). De nombreux membres de la commission n'étaient
pas des spécialistes de la politique en matière de drogue;
de ce fait ils ne devaient pas avoir de préjugés. La commission
s'est finalement penchée sur le sujet pendant 9 mois. Comme l'indique
la préface du rapport, elle s'est particulièrement orientée
vers la question d'une prohibition de toute forme de vente et de distribution.
La commission était en fin de compte partagée sur plusieurs
points. Elle a d'ailleurs procédé à un vote sur deux
points : la dépénalisation de l'usage du cannabis (disons
les drogues douces) et la dépénalisation des drogues illicites
en dehors du cannabis (disons les drogues dures). Une petite majorité
de la commission (9 pour, 8 contre) s'est prononcée pour la dépénalisation
de l'usage du cannabis. Le résultat du scrutin concernant la dépénalisation
des autres drogues que le cannabis a donné le résultat exactement
inverse (8 pour, 9 contre). Il est à noter que le président
Henrion, professeur de médecine et opposant à une libéralisation
avant que la commission ne se mette au travail, avait totalement changé
de position au bout de neuf mois. Non seulement il était désormais
partisan de la dépénalisation, mais même de la légalisation
du cannabis.
L'opinion de la légère majorité de la commission
qui a voté pour la dépénalisation de l'usage du cannabis,
va dans le même sens que celle du CCNE (Comité Consultatif
National d'Ethique). Cette majorité estime qu'une régulation
efficace est préférable à la situation actuelle.
Une régulation équivaudrait à (p. 82/83) :
- une interdiction de fumer du cannabis avant l'âge de 16 ans;
- une interdiction de fumer du cannabis dans tous les lieux publics;
- la répression de l'ivresse cannabique sur la voie publique;
- la création d'un délit de conduite sous l'emprise du cannabis;
- une interdiction de son usage dans des métiers dit de sécurité tel que contrôleur aérien, pilote, conducteur de TGV, etc.
Avant même la publication du rapport final de la commission, Pasqua avait déjà déclaré s'opposer à la dépénalisation. Le Premier Ministre Balladur a également exprimé son opposition dans une émission de télévision, diffusée le jour suivant la publication du rapport. Le rapport de la Commission Henrion a fait l'objet de beaucoup d'attention dans la presse. Les quotidiens Libération et Le Monde se sont tous deux prononcés dans leurs éditoriaux pour une dépénalisation de l'usage du cannabis.
Au cours des dernières campagnes des élections présidentielles,
aucun des "grands" candidats ne s'est prononcé en faveur
de la dépénalisation. Une seule candidate, Dominique Voynet
(Les Verts, environ 3% des voix) s'est exprimée en faveur d'une
légalisation contrôlée. Lionel Jospin (PS) s'est prononcé
(dans des termes assez modérés) contre la dépénalisation.
Par contre, il a exprimé de nombreuses critiques à l'égard
de la loi du 31 décembre 1970, qui "doit être débarrassée
de son arsenal répressif".
On dirait que les politiciens n'osent pas se prononcer en faveur de la
dépénalisation du cannabis, parce qu'ils ne veulent pas
se brûler les doigts sur ce sujet sensible. En effet, l'opinion
publique est d'après la plupart des sondages contre la dépénalisation.
Cela s'explique surtout par un manque général d'information.
Le débat sur la dépénalisation a cependant abouti
au fait que le sujet de la drogue est moins soumis à des tabous
et que l'opinion publique commence à être mieux informée.
Cela a eu pour conséquence un partage de l'opinion publique beaucoup
plus marqué qu'auparavant, que l'on peut comparer aux années
80, lorsqu'il existait un consensus général au sein de l'opinion
publique au sujet de la guerre à la drogue, consensus qui n'existe
plus actuellement. Cela est également dû au constat que la
"politique en matière de la toxicomanie" n'a pas été
la bonne réponse au problème, notamment en raison du nombre
élevé de toxicomanes infectés par le virus du Sida.
Cela a permis d'entamer la vraie discussion et il existe maintenant en
fait deux "camps", les partisans et les opposants.
Bien qu'on ne puisse pas encore dire avec certitude quel sera le résultat
du débat sur la drogue, il est à noter que les voix en faveur
d'une dépénalisation se font mieux entendre qu'auparavant
et que les spécialistes, en particulier, se prononcent de plus
en plus en faveur d'une modification de la politique en la matière.